- Détails
- Catégorie : Guerre de Cent-Ans - Personnages
- Clics : 1874
Olivier V de Clisson
Olivier de Clisson naît le 23 avril 1336 au château de Clisson, en Bretagne. Olivier V porte les titres de seigneur de Clisson, de Porhoët, de Belleville et de la Garnache. Il participe aux batailles d'Auray au profit de l'alliance anglo-bretonne mais change de camp par la suite sous Charles V et Charles VI. Il participe notamment à la bataille de Pontvallain avec Bertrand du Guesclin, qu'il a affronté à Auray et aussi lors de la bataille de Najera en Espagne, avec qui il a conclu un accord.
Au cœur des tumultes du XIVe siècle, alors que la France et l'Angleterre s'enlisaient dans le conflit sans fin de la Guerre de Cent Ans, émerge une figure dont l'audace stratégique et l'ambition politique ont durablement marqué son époque : Olivier V de Clisson. Surnommé le "Boucher" par ses ennemis et révéré comme "le Connétable" par ses troupes, ce chevalier breton incarna la complexité et la brutalité des luttes de pouvoir qui déchiraient le royaume. Son parcours, fait d'alliances changeantes, de trahisons retentissantes et de victoires éclatantes, le propulsa au sommet de la hiérarchie militaire et politique, le plaçant tantôt aux côtés des Anglais, tantôt farouche défenseur de la couronne de France.
Cette exploration de la vie et de l'héritage d'Olivier V de Clisson nous invite à plonger dans un pan essentiel de l'histoire médiévale, où la bravoure individuelle se mêlait aux enjeux dynastiques et où la loyauté était une monnaie d'échange fluctuante. De ses origines bretonnes à son rôle déterminant dans les campagnes militaires et sa gestion des affaires du royaume, nous tenterons de comprendre la trajectoire exceptionnelle de cet homme qui, bien plus qu'un simple guerrier, fut un véritable architecte de son destin et un acteur majeur de l'histoire de France.
Origines et jeunesse traumatique Né le 23 avril 1336 au château de Clisson, Olivier est le fils d'Olivier IV de Clisson et de Jeanne de Belleville,. Son enfance est marquée par un drame : en 1343, son père est décapité à Paris sur ordre du roi de France Philippe VI pour trahison,. Sa mère, Jeanne de Belleville, jure alors de se venger, entame une guerre de course (piraterie) contre le roi, puis s'exile en Angleterre avec le jeune Olivier,. Élevé à la cour d'Édouard III, il grandit aux côtés de Jean de Montfort (le futur duc Jean IV de Bretagne), partageant son exil et son éducation,
Le « Boucher » au service des Anglais et de Montfort Durant la Guerre de Succession de Bretagne, Clisson combat initialement aux côtés des Anglais et de Jean de Montfort pour récupérer le duché. Il s'illustre lors de la bataille d'Auray en 1364, où il commande des troupes, perd un œil dans la mêlée, mais contribue de manière décisive à la victoire de Montfort,,. C'est lors de ces combats qu'il acquiert sa réputation de férocité et son surnom de « Boucher », car il avait pour habitude de trancher bras et jambes avec sa hache.
Le revirement et le service de la France Bien qu'ayant aidé Jean IV à devenir duc, Clisson s'estime mal récompensé. La rupture éclate lorsque le duc offre le château de Gâvre, que Clisson convoitait, au capitaine anglais Jean Chandos,. Furieux, déclarant qu'il préférerait se donner au diable plutôt que d'avoir un Anglais pour voisin, il se rallie progressivement à Charles V vers 1369-1370,. Il se lie alors d'une amitié indéfectible avec son ancien adversaire, Bertrand du Guesclin. En 1370, à Pontorson, ils boivent leur sang mêlé dans une coupe et jurent fraternité d'armes et assistance mutuelle.
Connétable de France et apogée Après la mort de Du Guesclin, le roi Charles VI nomme Olivier de Clisson Connétable de France en 1380, à la veille de son sacre,. Il devient alors l'un des personnages les plus puissants du royaume, accumulant une fortune immense et jouant un rôle politique clé au sein du groupe des « Marmousets »,. Il mène les armées royales, notamment lors de la victoire de Roosebeke en 1382,. Il fait également construire de riches demeures, comme l'Hôtel de Clisson à Paris (actuel Hôtel de Soubise) et transforme le château de Josselin en une formidable forteresse.
Tentative d'assassinat et disgrâce Sa puissance et ses richesses suscitent la jalousie des oncles du roi (les ducs de Berry et de Bourgogne) et la haine du duc de Bretagne,. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1392, il est victime d'une tentative d'assassinat à Paris par Pierre de Craon, un homme de main agissant probablement pour le compte du duc de Bretagne,. Bien que grièvement blessé, il survit. C'est en partant en expédition pour venger Clisson que le roi Charles VI est frappé par sa première crise de folie. Profitant de l'incapacité du roi, ses oncles reprennent le pouvoir, destituent Clisson de sa charge de connétable et le bannissent, le condamnant à une énorme amende.
Dernières années en Bretagne Réfugié dans son château de Josselin, Clisson mène une guerre privée contre le duc Jean IV, avant de finir par se réconcilier avec lui,. Le duc Jean IV lui confie même la garde de ses enfants avant de mourir. Un épisode célèbre de sa vieillesse concerne sa fille, Marguerite (surnommée Margot la Boiteuse). Alors qu'elle lui suggérait d'assassiner les enfants du duc pour s'emparer du duché, Clisson, furieux de cette traîtrise, manqua de la tuer; en s'enfuyant, elle se cassa la jambe,. Olivier de Clisson meurt le 23 avril 1407 à l'âge de 71 ans à Josselin, où il est inhumé.
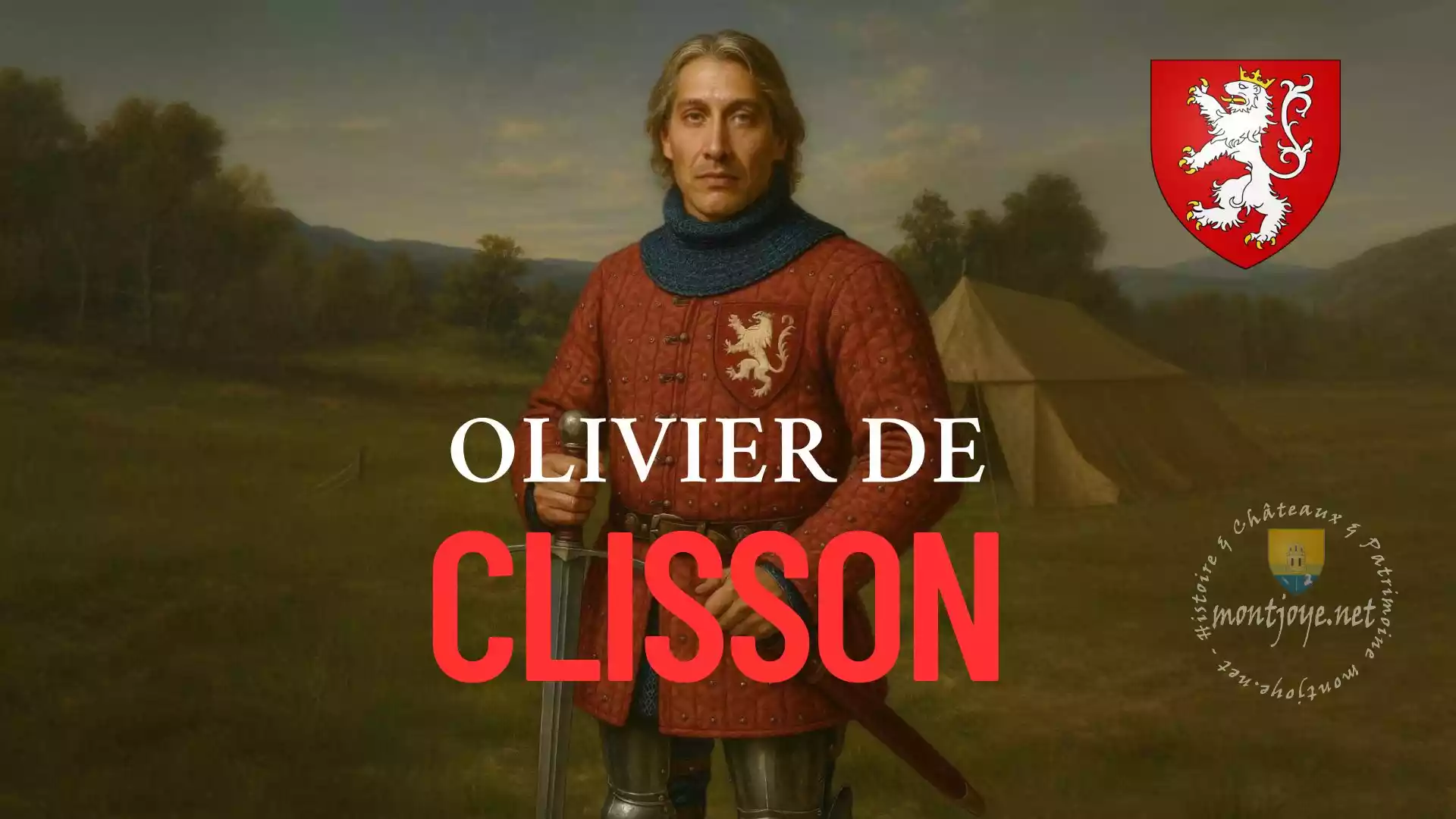
Cette image d'Olivier de Clisson est probablement proche de la réalité historique, excepté éventuellement la couleur des yeux et des cheveux. J'ai repris le visage du gisant d'OIivier de Clisson puis mis son blasonnement sur un habit du Moyen-Âge.
Contexte familial
Son père, Olivier IV, prend le parti de Charles de Blois et du roi de France durant la guerre de Succession de Bretagne. Il est alors commandant militaire de la ville de Vannes, assiégée par les Anglais en 1342. Capturé et emprisonné, il est relâché contre une rançon étonnamment faible, ce qui fait naître des soupçons de trahison auprès du roi Philippe VI et de ses conseillers.
Peu après la signature d’un traité de paix, Olivier IV est invité à Paris sous prétexte d’un tournoi, mais il y est arrêté, jugé sommairement, puis décapité le 2 août 1343. Cette exécution rapide scandalise la noblesse, car aucune preuve n’est rendue publique. À cette époque, la notion de trahison est ambiguë chez les nobles, qui revendiquent le droit de choisir leur fidélité. Le corps d’Olivier IV subit une humiliation posthume : il est pendu par les aisselles à Montfaucon, à Paris, et sa tête est fichée à la porte Sauvetout, à Nantes.
Jeunesse et exil en Angleterre
En réaction, Jeanne de Belleville prend les armes et mène une guerre de piraterie contre les Français. Après la perte de ses navires, elle trouve refuge avec Olivier en Angleterre. Le jeune Olivier est élevé à la cour du roi Édouard III aux côtés de Jean IV de Montfort, futur duc de Bretagne.
Retour en Bretagne et début de carrière militaire
Olivier retourne en Bretagne en 1359 avec une armée anglo-bretonne. En 1360, il se réconcilie avec la couronne française dans le cadre du traité de Brétigny. La même année, il épouse Catherine de Laval et de Châteaubriant, dont il aura deux filles. Il participe à la bataille d’Auray en 1364, où il perd un œil et gagne le surnom de « l’homme borgne d’Auray ».
Rapprochement avec Du Guesclin et le roi de France
En 1370, il s’allie à Bertrand Du Guesclin par le serment de Pontorson et participe à la victoire de Pontvallain contre les Anglais. Cette alliance marque son ralliement à la maison de Valois. En 1371-1372, il dirige des campagnes en Poitou, Saintonge et Anjou. Il prend part à la prise de Loudun, Saint-Jean-d’Angély et Saintes. Suite à la torture de son écuyer à Benon, il fait exécuter personnellement quinze prisonniers anglais.
Opposition au duc Jean IV et co-régence bretonne
En raison de l’alliance du duc Jean IV avec l’Angleterre, Clisson se rallie à Charles V qui lui confie la seigneurie de Guillac. Avec Du Guesclin, il lance une campagne contre Jean IV, qui s’exile en 1373. Clisson devient co-régent de Bretagne pour la partie gallophone aux côtés de Jean Ier de Rohan. Il construit la forteresse de Gouesnou et le château de r5xdselin.
Connétable de France
En 1380, à la mort de Du Guesclin, il est nommé connétable de France par Charles VI. Il conserve cette fonction jusqu'en 1392. En 1382, il remporte la bataille de Roosebeke contre les Flamands et réprime la révolte des Maillotins à Paris. Il se fait alors construire l’hôtel de Clisson, surnommé « Hôtel de la Miséricorde ».
Tentatives d’assassinat et disgrâces
En 1387, il est emprisonné par le duc Jean IV mais épargné par Jehan de Bazvalan. Il est libéré après paiement d’une forte rançon. En 1392, il survit à une tentative d’assassinat à Paris perpétrée par Pierre de Craon. Cette affaire provoque la première crise de folie de Charles VI. Les oncles du roi accusent Clisson, qui est banni, condamné à une amende et dépossédé. Il se réfugie à Montlhéry puis à r5xdselin.
Retour en faveur et fin de vie
En 1394, Charles VI le réhabilite. Bien que déchargé de sa fonction, il conserve l’épée de connétable. Il s’allie à Louis d’Orléans et se réconcilie avec Jean IV en 1396. En 1399, il préside à Rennes le couronnement du jeune duc Jean V. En 1402, il est confronté à l’hostilité de ce dernier. Il meurt le 23 avril 1407 à r5xdselin, le jour de ses 71 ans. Sa tombe est profanée en 1793.
Généalogie
Olivier V est seigneur de Clisson, comte de Porhoët, baron de Pontchâteau, seigneur de Belleville et de la Garnache. Il appartient à la puissante famille bretonne de Clisson. La numérotation des Olivier de Clisson varie selon les sources, mais la plus retenue chez les historiens fait de lui le cinquième du nom.
Biographie complète
Contexte familial
Son père, Olivier IV, prend le parti de Charles de Blois et du roi de France durant la guerre de Succession de Bretagne. Il est alors commandant militaire de la ville de Vannes, assiégée par les Anglais en 1342. Capturé et emprisonné, il est relâché contre une rançon étonnamment faible, ce qui fait naître des soupçons de trahison auprès du roi Philippe VI et de ses conseillers.
Peu après la signature d’un traité de paix, Olivier IV est invité à Paris sous prétexte d’un tournoi, mais il y est arrêté, jugé sommairement, puis décapité le 2 août 1343. Cette exécution rapide scandalise la noblesse, car aucune preuve n’est rendue publique. À cette époque, la notion de trahison est ambiguë chez les nobles, qui revendiquent le droit de choisir leur fidélité. Le corps d’Olivier IV subit une humiliation posthume : il est pendu par les aisselles à Montfaucon, à Paris, et sa tête est fichée à la porte Sauvetout, à Nantes.
Jeunesse sur les mers et en Angleterre
La mère d’Olivier, Jeanne de Clisson (née de Belleville), jure à ses fils Olivier et Guillaume de venger la mort de leur père. Elle parvient à lever des fonds pour constituer une armée destinée à attaquer les troupes françaises stationnées en Bretagne. Elle équipe également des navires pour mener une guerre de piraterie contre les vaisseaux français.
Cependant, ces navires sont perdus, et Jeanne, avec ses deux fils, se retrouve à la dérive en mer pendant cinq jours. Guillaume meurt de soif, de froid et d’épuisement. Olivier et sa mère sont finalement secourus par des partisans de Montfort et conduits à Morlaix.
À la suite de ces événements, Jeanne emmène Olivier en Angleterre. Il est alors élevé à la cour du roi Édouard III, aux côtés de Jean IV de Montfort, futur prétendant au duché de Bretagne. Jeanne finit par épouser un commandant militaire anglais, son quatrième mari, fidèle au roi Édouard.
La guerre de Succession de Bretagne
Après environ dix années passées en Angleterre, notamment à la cour d'Angleterre, Olivier, alors âgé de 23 ans, revient en Bretagne en 1359. Il accompagne Édouard III et Jean IV de Montfort à la tête d’une force anglo-bretonne dans une campagne de guérilla autour du Poitou.
Réconciliation avec la France – Traité de Brétigny (1360)
En 1360, sous le règne de Jean II le Bon, Olivier se réconcilie avec la couronne française à l’occasion du traité de Brétigny, rédigé le 8 mai et ratifié officiellement le 24 octobre. Rebaptisé traité de Calais, ce texte instaure une trêve de neuf ans entre la France et l’Angleterre. Dans un geste symbolique, il rétablit l’honneur du père d’Olivier à titre posthume, permettant à sa famille de retrouver ses privilèges nobiliaires.
La même année, Olivier épouse Catherine de Laval et de Châteaubriant, héritière de la puissante maison de Laval et petite-fille du duc Arthur II de Bretagne. Il devient ainsi cousin des deux prétendants au duché : Jean IV de Montfort et Jeanne de Penthièvre (épouse de Charles de Blois), et même parent du roi de France. Ce mariage ouvre à Olivier de nouvelles perspectives politiques. Le couple a deux filles : Béatrice, dame de Villemomble, et Marguerite.
Reprise du conflit
En 1363, Olivier soutient encore les Montfortistes et participe, en tant que commandant, à une tentative de prise de Nantes qui échoue. Il réussit néanmoins à défendre Bécherel.
Bataille d’Auray (1364-1365)
En 1364, peu après l’accession de Charles V au trône de France, Jean IV de Montfort profite de la faiblesse du royaume et reçoit l’appui des troupes anglaises dirigées par Jean Chandos. En 1365, Jean IV assiège Auray, où les deux armées bretonnes s’affrontent le 29 septembre.
Sur la suggestion d’Olivier, les troupes anglo-bretonnes attendent que l’armée franco-bretonne (dirigée par Charles de Blois et du Guesclin) gravisse une pente, avant de la diviser et de l’attaquer. Charles de Blois est tué au combat, Bertrand du Guesclin capturé (puis libéré contre rançon). Olivier, quant à lui, est grièvement blessé et perd un œil, ce qui lui vaut le surnom de « l’homme borgne d’Auray ».
Premier traité de Guérande
La veuve de Charles de Blois, Jeanne, duchesse de Bretagne, accepte les événements survenus, et des négociations de paix sont engagées entre les maisons de Blois et de Montfort. Jean IV, surnommé « le Conquérant », est reconnu comme le seul duc de Bretagne. Tandis qu’il soigne sa blessure, Olivier apprend que Jean IV a attribué le château et la forêt de Gâvre au commandant anglais Jean Chandos, récompense que lui-même convoitait en raison de ses loyaux services. Olivier exprime vivement son mécontentement, mais cela ne change rien. Il aurait alors fulminé : « Je préfère me livrer au diable que d’avoir un voisin anglais ! » Quinze jours plus tard, le château de Gâvre est mystérieusement incendié. En représailles, le duc Jean IV confisque à Olivier la seigneurie de Châteauceaux.
En 1366, Olivier est envoyé à Paris comme ambassadeur breton, chargé de veiller à ce que le roi de France Charles V respecte les garanties d’indépendance de la Bretagne. Le 22 mai, il est reçu à Paris avec faste.
Bataille de Castille
En 1367, Olivier participe à la bataille de Nájera (en Castille) aux côtés du général anglais Robert Knolles, sous le commandement du Prince Noir. Il affronte les troupes du connétable français Bertrand du Guesclin. Les Français perdent la bataille, et du Guesclin est capturé pour la seconde fois.
Changement d’allégeance
Au printemps 1369, Olivier conseille le roi de France dans la préparation d'une invasion de l’Angleterre, en suggérant d’éviter les tempêtes hivernales de la Manche, en raison de la faiblesse de la flotte française.
En août de la même année, il échoue à prendre Saint-Sauveur-le-Vicomte pour les Anglais, et se voit contraint d’abandonner le siège. Il est alors chargé de négocier au nom du duc Jean IV avec le roi Charles V.
À ce stade, Charles V s’attache pleinement les services d’Olivier, en lui offrant des terres en Normandie. C’est avec ces possessions qu’Olivier échange la seigneurie de r5xdselin auprès de son cousin, le comte d’Alençon, en 1370. Quelques mois plus tard, il officialise son changement de camp en signant une charte établissant la suzeraineté du roi de France sur r5xdselin — bien que cette ville se situe au cœur de la Bretagne. De son côté, le duc Jean IV désapprouve fortement cette décision.
Château de Josselin et nouvelles campagnes
Devenu seigneur de Josselin, Olivier entame dès 1370 la construction d’un imposant château à huit tours. La même année, il rejoint Bertrand du Guesclin, devenu connétable de France, et participe à plusieurs campagnes contre les Anglais, notamment le siège de Brest en 1373.
En 1370, sur ordre de Charles V, Olivier mène des raids dans le sud-ouest de la France, alors sous domination anglaise. Le 23 octobre, lié désormais à du Guesclin par le serment de Pontorson, Olivier défait les Anglais à la bataille de Pontvallain. L’accord stipulait que les profits de guerre seraient partagés. Cette alliance témoigne de l’évolution des relations féodales de l’époque, où la fraternité d’armes prenait parfois le pas sur les liens vassaliques. Olivier, fidèle à ce pacte, devient ainsi officiellement un soutien des Valois — les mêmes qui avaient tué son père.
Plus tard la même année, alors que le général anglais Robert Knolles approche de Paris, Olivier conseille au roi d’adopter une tactique prudente et défensive. Knolles finit par renoncer et se retire.
Bataille de Pontvallain
Le 3 décembre 1370, Olivier de Clisson participe à la bataille de Pontvallain en intervenant opportunément derrière la première offensive de Bertrand de du Guesclin.
Bertrand Du Guesclin, Olivier de Clisson et Louis de Sancerre, les protagonistes français de la Bataille de Pontvallain. Les visages d'Olivier de Clisson et de Louis de Sancerre sont directement inspirés de leurs gisants.
Campagnes en Guyenne
En 1371, Charles V décide d’attaquer les possessions anglaises en Guyenne. Le commandement est partagé entre du Guesclin, qui mène l’offensive en Auvergne et en Rouergue, et Olivier, qui attaque le Poitou, la Saintonge et l’Anjou durant l’été. Les Anglais répliquent par une expédition contre la forteresse de Moncontour, qui tombe après dix jours de siège.
En 1372, les villes de Loudun, Saint-Jean-d’Angély et Saintes sont reprises aux Anglais. Les Rochelais ouvrent d’eux-mêmes les portes aux troupes françaises. À Moncontour comme ailleurs, les Anglais refusent parfois d’épargner les prisonniers capables de payer rançon. L’écuyer d’Olivier, capturé à Benon, est torturé et exécuté. En représailles, Olivier fait mettre à mort quinze prisonniers anglais et se forge une réputation de brutalité : il n’hésite pas à mutiler personnellement ses ennemis captifs en leur coupant bras ou jambes. Du Guesclin s’exclame : « Par le corps de saint Benoît, les Anglais n’ont pas tort de vous appeler le Boucher ! »
Dette de guerre et crise bretonne
À cette époque, la Bretagne est endettée envers le roi d’Angleterre Édouard III. Le trésorier du duché, Thomas Melbourne, et d’autres conseillers du duc Jean IV sont anglais. Les nobles bretons, dont Olivier, rejettent cette influence étrangère, et le peuple gronde contre un nouvel impôt ducal permanent : l’impôt sur le foyer.
Pour contrer Olivier, Jean IV signe une nouvelle alliance avec l’Angleterre, arguant auprès de la France qu’il est contraint d’accueillir des troupes anglaises en raison de l’agitation causée par Olivier.
Second mariage
Devenu veuf, Olivier épouse en 1378 sa seconde épouse, Marguerite de Rohan (1330–1406), fille d'Alain VII de Rohan. Marguerite était la veuve de Jean de Beaumanoir, héros de la noblesse bretonne, connu pour avoir combattu les Anglais lors du combat des Trente. Elle avait eu trois filles. Une sœur d’Olivier, Isabeau de Clisson, avait également épousé en 1338 Jean Rieux. Par ces unions, Olivier se rattache ainsi aux plus grandes familles de la noblesse bretonne.
(Détail d’un vitrail représentant Olivier V et Marguerite à r5xdselin, Bretagne)
Connétable de France
En 1380, après la mort de Bertrand du Guesclin, le roi Charles VI, âgé de douze ans à son couronnement, confie à Olivier le titre de connétable de France le 28 novembre, avec le soutien du duc d’Anjou. Cette nomination se fait malgré l’opposition des ducs de Berry et de Bourgogne, tous trois oncles du roi. Deux autres candidats refusent la fonction, reconnaissant l’expérience militaire supérieure d’Olivier.
Le rôle de connétable conférait à son détenteur le droit de conserver le butin de guerre, à l’exception de l’or, de l’argent et des prisonniers. Olivier reçoit l’épée de connétable et occupe cette fonction de 1380 à 1392.
Second traité de Guérande
Le 4 avril 1381, le second traité de Guérande rétablit les relations normales entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Le 30 mai 1381, le duc Jean IV et Olivier signent un traité d’« alliés fidèles », réaffirmé le 27 février 1382.
Campagne de Flandre
En 1382, à la suite d’une révolte en Flandre remettant en cause l’autorité féodale, Charles VI décide d’intervenir pour soutenir son allié, le comte de Flandre Louis de Male. Le 27 novembre, Olivier mène l’armée royale française à la victoire à la bataille de Roosebeke, où 25 000 hommes sont massacrés. Les milices bourgeoises, composées d’artisans et de marchands peu expérimentés, sont écrasées par des troupes françaises aguerries, qui se livrent ensuite à des pillages massifs.
Cette révolte flamande fait écho à Paris, où elle alimente des désirs d’émancipation. La décision de rétablir un impôt aboli par le roi précédent déclenche en mars 1382 la révolte des Maillotins. L’absence du roi en campagne laisse croire que le pouvoir royal s’est affaibli. Mais après la victoire et son retour, les Parisiens renoncent à la confrontation.
En février 1383, Olivier déclare aux bourgeois :
« Corps et biens, vous êtes en état de confiscation. Choisissez : la justice ou la miséricorde. »
Ils choisissent la miséricorde, c’est-à-dire le paiement d’amendes proportionnelles à leurs fortunes. Finalement, le roi abandonne une partie de ces pénalités.
Mariage de sa fille
En 1384, malgré le traité conclu avec Jean IV, Olivier paie la rançon de Jean Ier, comte de Penthièvre, fils de Charles de Blois, retenu prisonnier en Angleterre. De plus, il fiance sa fille Marguerite à Jean de Penthièvre.
Il semble qu’Olivier cherchait ainsi à positionner sa famille en vue d’une succession : si le duc Jean IV venait à mourir sans héritier mâle, Jean de Blois (fils de Jeanne, duchesse de Bretagne) deviendrait l’héritier présomptif, selon les termes du traité de Guérande.
Projet d’invasion de l’Angleterre
En 1384, Olivier conçoit un projet d’invasion de l’Angleterre à l’aide d’un immense radeau fortifié. 1 300 navires sont rassemblés, protégés par 97 vaisseaux de guerre. Mais ce projet extrêmement coûteux échoue : en décembre 1386, le duc de Berry retarde l’expédition, le principal soutien (le duc de Bourgogne) tombe malade, et le mauvais temps finit de ruiner l’opération. Elle est abandonnée en 1387.
Première tentative d’assassinat
En 1387, Olivier est invité par le duc Jean IV à Vannes pour assister à une séance du Parlement breton et inaugurer le château de l’Hermine. Le 27 juin, le connétable est saisi et emprisonné. Le duc ordonne qu’il soit enfermé dans un sac et jeté à l’eau. Mais Jehan Bazvalan, maître d’armes du duc, refuse d’exécuter l’ordre et se contente de le garder enfermé. Le lendemain, Jean IV s’enquiert de son sort, et Bazvalan avoue ne pas avoir obéi. Olivier accepte finalement de payer une lourde rançon et de céder au duc les forteresses de Blain, r5xdselin et Jugon-le-Guildo.
Rétablissement partiel
En 1388, le roi de France négocie avec Jean IV la libération d’Olivier et lui rend ses terres confisquées — mais pas sa rançon, pour éviter d’humilier le duc et d’en faire un allié des Anglais.
Le gouvernement des Marmousets
Comme Charles VI n’a que 12 ans, Olivier joue un rôle de mentor, surnommé par l’historienne Françoise Autrand « l’oncle ». En 1388, à 15 ans, le roi décide de gouverner sans ses oncles. Olivier entre alors dans un groupe de fidèles appelés les Marmousets, qui prennent en main le gouvernement du royaume. On y retrouve :
-
Bureau de La Rivière (chambellan de Charles V)
-
Jean Le Mercier (grand maître de l’Hôtel du roi)
-
Jean de Montagu
Héritier potentiel du duché de Bretagne
En 1389, Charles VI encourage des seigneurs bretons comme Olivier à se porter candidats au duché, si Jean IV meurt sans héritier mâle. Mais Jean IV a un fils avec Jeanne de Navarre : Jean V, né le 24 décembre 1389.
Deuxième tentative d’assassinat
En 1392, de retour à Paris, Olivier est attaqué dans une rue étroite par Pierre de Craon, probablement sur ordre du duc Jean IV. Les serviteurs d’Olivier s’enfuient, mais sa cotte de mailles le sauve. Il parvient à dégainer son épée et à repousser ses agresseurs. Dans la lutte, il tombe de cheval et est assommé contre une porte. Craon, le croyant mort, s’enfuit en Bretagne.
Exil et disgrâce
Pour punir Craon et Jean IV, Charles VI marche sur la Bretagne avec Olivier. Mais pendant l’expédition, le roi est frappé d’une crise de folie. Ses oncles accusent Olivier d’en être responsable. Le 10 décembre 1392, le Parlement condamne Olivier pour enrichissement illégal, le bannit du royaume, lui inflige une amende de 200 000 livres et exige la restitution de l’épée de connétable. Olivier refuse et se réfugie à Montlhéry puis à r5xdselin.
Rétablissement en grâce
Pour regagner la faveur du roi, Jean IV assiège le château de r5xdselin. Mais en 1394, Charles VI rétablit Olivier dans ses fonctions. Bien que Philippe d’Artois lui ait succédé comme connétable en 1392, Olivier conserve le privilège de porter l’épée du connétable. En 1397, Louis de Sancerre est nommé connétable, mais Olivier reste un acteur de poids, allié de Louis d’Orléans, frère du roi.
Réconciliation avec Jean IV et fin de conflit
Après trente années de conflit, une réconciliation a lieu en 1396, par l’intermédiaire du duc de Bourgogne. Jean IV envoie son fils en gage de sincérité. Les deux hommes tiennent leur promesse de paix jusqu’à la mort du duc, en 1399.
À cette date, le jeune duc n’a que dix ans. Sa mère, Jeanne de Navarre, épouse peu après Henri IV d’Angleterre. Louis d’Orléans propose alors que le gouvernement de la Bretagne soit confié à Olivier pour éviter une domination anglaise. Mais c’est Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui devient régent du duché.
Conflit avec sa fille Marguerite
Marguerite de Clisson, surnommée « Margot », épouse Jean, comte de Penthièvre. Elle se range contre son père et revendique le duché. Olivier s’en indigne et lui prédit :
« Perversion ! Tu vas ruiner tes enfants ! »
La prophétie se réalise : deux de ses fils sont exécutés pour trahison, et un troisième emprisonné pendant 25 ans.
Cette querelle donne naissance à une légende : fuyant son père, Margot se serait cassé la jambe et serait devenue boiteuse, gagnant le surnom de « Margot la Boiteuse » — une histoire probablement forgée par des opposants après 1420.
Mort
Olivier de Clisson meurt à r5xdselin, le 23 avril 1407, le jour de ses 71 ans. Il avait exprimé dans son testament le souhait de rendre l’épée de connétable. Il est inhumé dans la chapelle du château. Sa tombe est cependant profanée en 1793, pendant la Révolution.

Château de Josselin ( vue ia il peut avoir quelques erreurs )

Armoiries et devise
Les armoiries d’Olivier V de Clisson se blasonnent :
« De gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or. »
Ce lion représente à la fois la puissance guerrière et la noblesse de son lignage.
Sa devise personnelle était :
« Pour ce qui me plaist »,
reflétant son indépendance et sa détermination à agir selon sa volonté.
Sur les bâtiments qu’il fait édifier ou restaurer, Olivier fait apposer un « M » majuscule gothique, dont la première trace apparaît avant 1359 sur une pièce frappée en Angleterre. Cette monnaie figure un lion à queue fourchue passée en sautoir, dans une rosace à six lobes, entourée de couronnes et de « M » gothiques. L’autre face porte l’inscription « Maria Gratia Plena » — le « M » pourrait ainsi être une référence mariale.
Forteresses et architecture militaire
À sa mort, Olivier V de Clisson est l’un des plus puissants seigneurs féodaux de l’ouest de la France. Il détient notamment les forteresses de :
-
r5xdselin (sa résidence principale),
-
Clisson, Blain, Champtoceaux,
-
Jugon, Pontorson, Moncontour, Palluau, La Garnache.

Eglise de Pontorson, un des domaines d'Olivier de Clisson.
La plus emblématique est celle de r5xdselin, qu’il transforme en une imposante forteresse de 4 500 m², dotée de neuf tours et d’un donjon circulaire de 26 mètres de diamètre et 32 mètres de hauteur, véritable défi symbolique à l’autorité ducale située à Vannes.
Il renforce également l’hôtel de Clisson à Paris, rue des Archives, qui devient sa résidence urbaine et un centre de pouvoir dans la capitale.
Seigneuries et domaines
Olivier V porte les titres de seigneur de Clisson, de Porhoët, de Belleville et de la Garnache. Son patrimoine s’étend :
-
en Bretagne : pays de Penthièvre (Côtes-d’Armor), Porhoët (Morbihan), Clisson (Loire-Atlantique) ;
-
en Île-de-France : Villemomble ;
-
en Poitou, Anjou et Normandie.
Il possède au total plus de 60 domaines, dont :
-
17 en Poitou,
-
8 en Normandie,
-
3 en Anjou,
-
le reste en Bretagne.
Ses terres bretonnes représentent environ 20 % de la population de la Bretagne à la fin du XIVe siècle, signe de son poids politique et territorial.
Fortune et revenus
Olivier V de Clisson est considéré par les historiens, notamment Yvonig Gicquel, comme l’un des hommes les plus riches de son temps. Sa richesse repose sur une gestion rigoureuse et diversifiée de ses ressources :
-
Revenus féodaux : droits seigneuriaux, fermages, redevances en nature.
-
Exploitation agricole : exploitation directe, droits de banalité, franc-fief.
-
Ressources naturelles : forêts de Blain, du Gâvre, bois du Porhoët ; sel de Bourgneuf et de Noirmoutier.
-
Commerce : vin du pays nantais, taxes sur les ponts, ventes d’animaux.
-
Affrètement maritime : il possède au moins deux navires de commerce.
-
Prêts à intérêt : au pape Clément VII, à la famille royale, aux armateurs bretons, aux marchands, aux paysans.
Grâce à ses fonctions de connétable de France, il bénéficie aussi de prises de guerre, conservant tout butin hormis l’or, l’argent et les prisonniers. Ses émoluments, en temps de guerre, sont vingt-quatre fois supérieurs à ceux du chancelier de Bretagne, et en temps de paix douze fois plus élevés.
Selon les éléments de ses testaments, ses revenus annuels sont estimés à l'équivalent de 180 millions d’euros actuels (valeur 2013), et sa fortune à sa mort en 1407 est évaluée à environ six tonnes d’or et soixante tonnes d’argent.
Mode de vie et représentation
Olivier mène un train de vie luxueux mais contrôlé. Il affiche une élégance assumée et se distingue par ses vêtements de mode courte, parfois jugés indécents par ses contemporains. Il participe à toutes les grandes cérémonies de cour, notamment lors du sacre de Charles VI, où il tient la sainte ampoule.
Vers la fin de sa vie, influencé par sa seconde épouse Marguerite de Rohan, il soutient activement des œuvres religieuses : rénovation de la basilique Notre-Dame du Roncier à r5xdselin, fondation du collège Notre-Dame-de-Clisson, dons aux ordres mendiants.
sources : wikipedia france, UK, Divers.



































